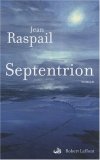|
Il
est parmi l'œuvre romanesque considérable - et très sous-estimée - du
Maître contemporain de l'école fantastique américaine, l'écrivain
Stephen King, une longue nouvelle intitulée Les Langoliers, dans
laquelle est narrée la mésaventure survenue à une poignée de passagers
dont l'avion a franchi par mégarde une faille
temporelle, les transportant ainsi quelques instants dans le passé.
Le monde qu'ils découvrent, lorsque l'appareil finit par se poser à Bangor
(Maine) - lieu de résidence de l'écrivain -, ressemble à s'y méprendre au monde
ordinaire, excepté qu'aucune créature vivante ne l'habite, ni
hommes ni animaux, que les sons ne s'y répercutent pas, que la nourriture
y est dépourvue de toute saveur et qu'aucune odeur ne se diffuse dans
l'air ambiant. Monde d'une épouvantable fadeur, en somme, immobile, dans
l'attente des fameux Langoliers, créatures fabuleuses, dévoreuses de
mondes, qui, à coups de grignotages incessants, font basculer petit à
petit ce reliquat de vie passée dans le néant...
Il
y a de cela dans le Septentrion de Jean Raspail. Outre le
caractère proprement fantastique de l'action, le monde qui y est dépeint
n'est pas sans évoquer celui décrit par King dans sa nouvelle, les
Langoliers y étant remplacés par une masse humaine grise. Septentrion
n'est pas non plus sans évoquer un autre classique de la littérature
fantastique, Body Snatchers (L'Invasion des Profanateurs, Denoël,
1994) de Jack Finney, qui raconte comment des extraterrestres, sous la
forme, initialement, de grosses cosses, se fondent littéralement dans le
corps des êtres humains pour se substituer à eux, transformant
ainsi en étrangers, du jour au lendemain, les plus proches amis, le
mari et la femme, les enfants et leurs parents...
«On aurait
dit une invasion de cloportes», déclare pour sa part l'un des
"survivants" de Septentrion. «A bien les regarder, on
les connaissait presque tous. Mais on a subitement trouvé qu'ils avaient
de sales gueules. Ça nous a fait un choc! Des copains de régiment! On a
essayé de causer, mais on a vite renoncé. Ils nous regardaient par en
dessous, sans répondre. Vraiment des têtes de faux frères, et comme
ça! sans prévenir! un matin!» (Septentrion, p.92/93)
Bien
entendu, Septentrion n'est pas non plus sans faire écho au Camp
des Saints, à six années d'intervalles, et, d'un strict point de vue
littéraire, il s'agit d'une plus grande réussite, Jean Raspail n'étant
jamais aussi bon que lorsqu'il se fait pur conteur et nous embarque
dans une épopée aux confins du réel et de l'imaginaire, tandis que ses
évocations du présent revêtent souvent un caractère peu crédible, qui
frôle la caricature, quand bien même elles se voudraient
avant tout métaphoriques - que l'on songe ici, par exemple, aux brèves
incursions du présent dans le monde clos sur lui-même, quasi intemporel,
des Yeux d'Irène...
Ici,
le "présent du monde réel" est tenu à distance par la force
des choses, ramené au rang de symbole. On peut donc suivre Jean Raspail
sans réserve, dans cette fuite éperdue entre un hier en voie de
dissolution et un improbable demain... Car il n'y a pas de lendemains qui
chantent chez Jean Raspail. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura
jamais. Il n'y a que le voyage pour le voyage; le moment de l'entre-deux,
qui, comme nous avons déjà été mentionné par ailleurs (voir Parcours)
est le seul vrai monde de l'écrivain, son
véritable chez
lui. «On ne peut rien contre ceux qui viennent. Sinon s'enfuir encore
plus loin...» (Septentrion, p.284)
Dans
cette perspective, Septentrion est donc aussi le roman de l'écrivain lui-même
- ce n'est évidemment pas un hasard si le narrateur du roman, Jean Rudeau,
porte les mêmes initiales de Jean Raspail. Un Jean Raspail qui, après de longues années à patrouiller de par le monde,
s'est sédentarisé et se sent probablement,
à ce moment précis, un peu à l'étroit dans la France d'alors, comme s'il
s'était produit dans sa vie une réitération de la situation qu'il avait
connue au début des années 50, peu avant d'entamer son premier grand
voyage... Ainsi, à l'instant de quitter
à jamais sa maison, de mettre les voiles, de partir vers l'inconnu, vers
le Septentrion, Jean Rudeau note-t-il :
«Je me
sentais gai, léger, rajeuni. Délivré. Maintenant, ils pouvaient venir.
Moi aussi, j'avais quelque chose à leur abandonner, comme on se
débarrasse d'un vieux pardessus élimé quand arrivent des jours
meilleurs. »
Si,
avec Le Camp des Saints, Jean Raspail avait en somme signifié son
adieu à un monde dans lequel il ne se sentait plus guère à sa place,
avec Septentrion, il tourne radicalement la page (l'expression
revient à plusieurs reprises sous sa plume), pour s'acheminer vers un
ailleurs où il se dérobera aux vains "débats de
société": le mythe. Et ce faisant, il entre
pleinement en littérature, sans plus aucun compromis avec l'époque
présente.
C'est, si je ne me trompe, la
philosophe Simone Weil qui a écrit «Parlez de choses éternelles pour être
toujours d'actualité.»
Aussi
est-ce de loin, désormais, que Jean Raspail contemplera le Présent, le
faisant entrapercevoir à ses personnages, au détour d'une route, comme
dans Les Yeux d'Irène, ou à la faveur d'une contemplation
empreinte d'une distance pleine de désillusions, comme dans Sire...
La rupture est complète, têtue, obstinée, ainsi que la figure d'Antoine
de Tounens en portera bientôt témoignage. Quant à l'écrivain Jean
Raspail, il suivra désormais sa propre route, sans plus se soucier
du reste, dans sa Patagonie à lui, pour ainsi dire. Car
le Présent ne coïncide plus avec la Vie, et si la Vie peut encore se
laisser embrasser, ce n'est certes plus en la vivant au présent...
La
Vie est ailleurs et ne peut plus être rattrapée que dans et par son
évocation rêvée, fantasmée.
Ainsi,
le voyage de Septentrion se confond-il avec d'autres voyages à
venir, chez Raspail - voyages imaginaires, comme seule l'imagination des enfants
- et des écrivains - peut en concevoir, transfigurant, par exemple, un vieil omnibus noir,
abandonné au fond des communs, en «théâtre de tous nos rêves» :
«A
six, nous nous y prélassions. Nous y passions la moitié de nos
journées. C'était un palais ambulant. Ambulant: nous n'arrêtions pas de
voyager. Nous traversions la Sibérie au galop, poursuivis par des meutes
de loups, l'Amérique infestée d'Indiens ou les tumultes d'une bataille
perdue pour porter secours à l'héritier du trône...» (L'île Bleue,
p.28)
Et
telle sera désormais la substantifique moelle des voyages de Jean
Raspail. Voyages convoqués par le rêve, par le désir tragique de
rejoindre la Vie, de se fondre de nouveau en elle, par-delà l'improbable
horizon qui en marque le terme. Vivre, en somme, en pourchassant la vie
qui a fui...
Dans
cet ordre d'idée, les voyageurs de Septentrion se confondent donc avec
tous ces peuples qui, sans cesse pourchassés, réduits à un tout petit
groupe misérable, hors du temps, se sont repliés de plus en
plus loin, jusqu'à atteindre le bout du monde - jusqu'à ne plus
être que silhouettes qui s'estompent au-delà de la Terre de
feu...
©
Philippe Hemsen
|
|
EXTRAITS
|
|
Les
signes
s'accumulaient, sans que nous en percevions, tout au nord du pays,
loin de la capitale et de ses clochers dorés, les exactes conséquences.
Nous
comprenions vaguement comment, sans savoir réellement pourquoi. Tout
allait vite, avec des modifications tangibles dans notre vie de tous
les jours, mais rien n'était net. Tout changeait dans le flou, comme
si une sorte de guimauve envahissante, poisseuse et tenace, transfusée
dans les artères vivantes du pays, gelait les cœurs et les âmes, et
aussi les rouages de l'État, les activités de la nation, pétrifiant
jusqu'au corps profond de la population. Dans quel but ? On pouvait
compter sur les doigts des deux mains ceux qui en étaient à peu près
conscients dans notre petite ville, à Saint-Basile, chef-lieu du
Septentrion. Tout juste comprenions-nous que s’
avançait rapidement, de
façon informe et inexorable, une sorte d'éternité différente.
Rien ne ressemblerait plus à hier, rien ne changerait plus jamais,
une fois les choses accomplies, je crois que je tiens le mot clef :
cette annonce d'une éternité engendrait
chez aucun d'entre nous, non pas tellement la peur, diffuse,
impalpable, mais la paralysie. Quand l'homme veut changer l'homme, se
substituant au Créateur, qu'il le change et qu'il l'a changé, est-ce
qu'on peut, humainement parlant, s'opposer à la marche de cette éternité
nouvelle ?
|
|
 |
|
Au temps de ma jeunesse, tant de pays,
sur divers continents, s'étaient enfoncés de cette façon dans la
nuit aveuglante des systèmes régénérateurs, chacun y devenant à
la fois dictateur et esclave, double nature de l'homme nouveau.
Cela n'avait pas toujours été sans mal. On avait vu des nations vêtues
de noir s'amputer, pour aller plus vite, d'un tiers de leur
population, membre pourri et sacrifié au sauvetage du corps pur.
D'autres pays procédaient différemment, sous des drapeaux et des
idéologies d'apparence quelquefois contraire, mais avec une seule méthode
éprouvée : autopersuasion par contagion. Tels étaient le poids et
la force de l'irradiant cerveau collectif qu'il devenait humainement
impossible de penser autrement.
Et si certains rechignaient à s'y faire, d'autres se chargeaient de
leur arracher le cœur pour leur ouvrir les yeux, choisis, ou plutôt
volontaires spontanés, parmi les proches, les parents, les amis, les
voisins, les confrères, les collègues, les chefs ou les subordonnés,
implacables légions. Il en sortait de partout, jusque dans chaque
famille, du fond même des lits conjugaux, du tabernacle des églises
ou de la tablée quotidienne des petits bistrots de l'amitié. Plus n'était
besoin de prisons, d'asiles de redressement, de camps de régénération
ou de stimulation collective. A la fin, chacun se jugeait soi-même
selon le code unique sans plus solliciter la vigilance des autres, se
déclarait coupable et s'enfermait dans sa propre prison intérieure,
le cœur et l'âme transformés en cachot nu et lisse d'où le prisonnier
volontaire sortait définitivement métamorphosé.
Ainsi avaient péri, de nation en nation, le goût de la singularité, la
soif des différences fondamentales et jusqu'à la merveilleuse haine
qu'engendraient naguère nos bienfaisantes inégalités divines. Quelles
que fussent sa race, sa culture et ses origines, le même type d'homme
peuplait désormais les deux tiers de la planète et le plus effrayant,
c'est qu'il semblait satisfait
!
|
|
 |
|
Au demeurant, du temps qu’il y a
mille ans je dévorais Shakespeare, la lecture de chevet de mes vingt
ans, et Musset, le Musset dramatique, celui de Lorenzaccio,
ce que je relisais avec le plus d’émotion et qui libérait
aussitôt le flot de mon imagination, qui me semblait chargé de
toutes les promesses tragiques, c’était le grand mouvement des âmes
et des hommes déjà tout entier contenu dans la simple énumération
des personnages placée au début de l’œuvre, entre le titre et la
scène 1 de l’acte I. Je m’y voyais! J’en étais! Pas le héros,
bien sûr, ni même aucun des personnages dûment pourvus d’un nom,
mais la foule innombrable qui prenait vie en bas de page sur trois ou
quatre lignes serrées, souvenez-vous : officiers de la garde, un
bouffon, deux fossoyeurs, soldats et courtisanes, messagers, gens de
suite, dames de la cour, matelots, un héraut, musiciens,
gentilshommes, serviteurs, trois sorcières, un moine, un prélat,
un bossu, un lépreux, un orfèvre, deux précepteurs et deux enfants,
pages, un banni, un traître, écoliers, domestiques, bourgeois,
manants et filles de joie, servantes, un esclave maure, sans oublier
le spectre car chacun traîne le sien, mais j’ai tout mélangé et
sans doute en ai-je ajouté de mon cru, bref je n’avais que la peine
d’y choisir mon emploi. Aujourd’hui nous conviendrons d’une
distribution plus modeste mais enfin le principal y est, hussards
verts, dragons bleus, officiers de la garde, un prêtre nain, un
histrion de castelet, le spectre d’un prince, deux courtisanes, un
condottiere, gens du peuple, un prévôt d’armes... Je vous laisse
achever la liste de laquelle on retranchera tout de même l’emploi
inutile de traître pour y joindre seulement celui d’escrivain, de
chantre, de chroniqueur, de scribe, comme on voudra, dans ce domaine
comme dans les autres j’ai renoncé à toute ambition et
d’ailleurs qui me lira au terme septentrional de mon récit ? Si
je donne quelquefois en écrivant l’impression de m’adresser à
quelqu’un, qu’on sache que c’est à moi-même que je parle et
que j’y entends aussi l’écho de ma vie manquée...
|
|
 |